Six Questions à Anthony Freestone, Aurora 1/6
Pablo Duràn
La transcription de cette interview est visible ci-dessous.
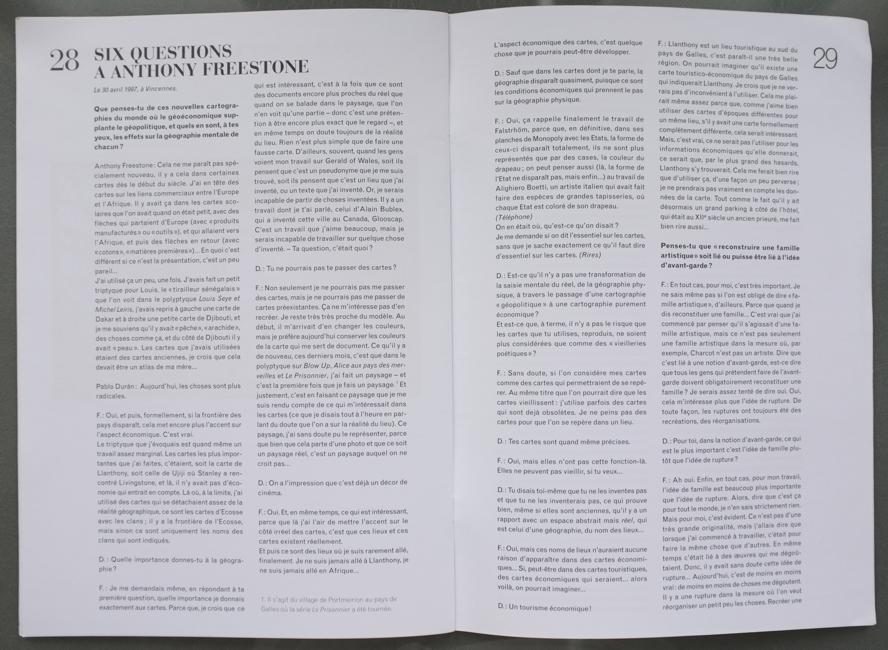
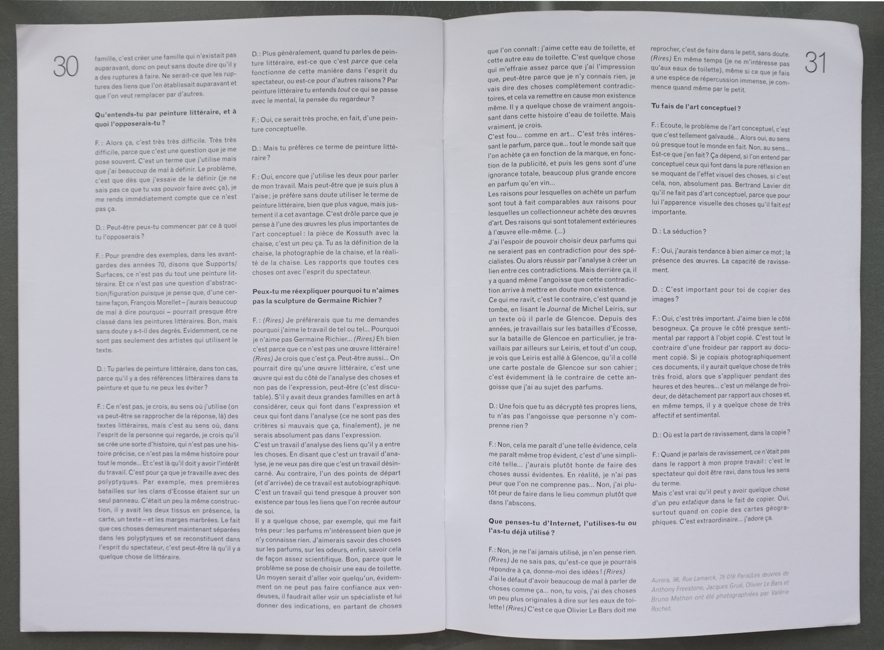
Pablo Duràn : Que penses-tu de ces nouvelles cartographies du monde où le géoéconomique supplante le géopolitique, et quels en sont, à tes yeux, les effets sur la géographie mentale de chacun ?
Anthony Freestone: Cela ne me paraît pas spécialement nouveau, il y a cela dans certaines cartes dès le début du siècle. J’ai en tête des cartes sur les liens commerciaux entre l’Europe et l’Afrique. Il y avait ça dans les cartes scolaires que l’on avait quand on était petit, avec des flèches qui partaient d’Europe (avec «produits manufacturés» ou «outils»), et qui allaient vers l’Afrique, et puis des flèches en retour (avec «cotons», «matières premières »)… En quoi c’est différent si ce n’est la présentation, c’est un peu pareil… J’ai utilisé ça un peu, une fois. J’avais fait un petit triptyque pour Louis, le «tirailleur sénégalais» que l’on voit dans le polyptyque Louis Seye et Michel Leiris, j’avais repris à gauche une carte de Dakar et à droite une petite carte de Djibouti, et je me souviens qu’il y avait «pêche», «arachide», des choses comme ça, et du côté de Djibouti il y avait «Peau», Les cartes que j’avais utilisées étaient des cartes anciennes, je crois que cela devait être un atlas de ma mère…
D. : Aujourd’hui, les choses sont plus radicales.
F.: Oui, et puis, formellement, si la frontière des pays disparaît, cela met encore plus l’accent sur l’aspect économique. C’est vrai.
Le triptyque que j’évoquais est quand même un travail assez marginal. Les cartes les plus importantes que j’ai faites, c’étaient, soit la carte de Llanthony, soit celle de Ujiji où Stanley a rencontré Livingstone, et là, il n’y avait pas d’économie qui entrait en compte. Là où, à la limite, j’ai utilisé des cartes qui se détachaient assez de la réalité géographique, ce sont les cartes d’Écosse avec les clans; il y a la frontière de l’Écosse, mais sinon ce sont uniquement les noms des clans qui sont indiqués.
D.: Quelle importance donnes-tu à la géographie?
F.: Je me demandais même, en répondant à ta première question, quelle importance je donnais exactement aux cartes. Parce que, je crois que ce qui est intéressant, c’est à la fois que ce sont des documents encore plus proches du réel que quand on se balade dans le paysage, que l’on n’en voit qu’une partie — donc c’est une prétention à être encore plus exact que le regard —, et en même temps on doute toujours de la réalité du lieu. Rien n’est plus simple que de faire une fausse carte. D’ailleurs, souvent, quand les gens voient mon travail sur Gerald of Wales, soit ils pensent que c’est un pseudonyme que je me suis trouvé, soit ils pensent que c’est un lieu que j’ai inventé, ou un texte que j’ai inventé. Or, je serais incapable de partir de choses inventées. Il y a un travail dont je t’ai parlé, celui d’Alain Bublex, qui a inventé cette ville au Canada, Glooscap. C’est un travail que j’aime beaucoup, mais je serais incapable de travailler sur quelque chose d’inventé. — Ta question, c’était quoi ?
D.: Tu ne pourrais pas te passer des cartes?
F.: Non seulement je ne pourrais pas me passer des cartes, mais je ne pourrais pas me passer de cartes préexistantes. Ça ne m’intéresse pas d’en recréer. Je reste très très proche du modèle. Au début, il m’arrivait d’en changer les couleurs, mais je préfère aujourd’hui conserver les couleurs de la carte qui me sert de document. Ce qu’il y a de nouveau, ces derniers mois, c’est que dans le polyptyque sur Blow Up, Alice aux pays des merveilles et Le Prisonnier, j’ai fait un paysage — et c’est la première fois que je fais un paysage.’ Et justement, c’est en faisant ce paysage que je me suis rendu compte de ce qui m’intéressait dans les cartes (ce que je disais tout à l’heure en parlant du doute que l’on a sur la réalité du lieu). Ce paysage, j’ai sans doute pu le représenter, parce que bien que cela parte d’une photo et que ce soit un paysage réel, c’est un paysage auquel on ne croit pas…
D.: On a l’impression que c’est déjà un décor de cinéma.
F.: Oui. Et, en même temps, ce qui est intéressant, parce que là j’ai l’air de mettre l’accent sur le côté irréel des cartes, c’est que ces lieux et ces cartes existent réellement. Et puis ce sont des lieux où je suis rarement allé, finalement. Je ne suis jamais allé à Llanthony, je ne suis jamais allé en Afrique… L’aspect économique des cartes, c’est quelque chose que je pourrais peut-être développer.
D.: Sauf que dans les cartes dont je te parle, la géographie disparaît quasiment, puisque ce sont les conditions économiques qui prennent le pas sur la géographie physique.
F.: Oui, ça rappelle finalement le travail de Falstrhöm, parce que, en définitive, dans ses planches de Monopoly avec les Etats, la forme de ceux-ci disparaît totalement, ils ne sont plus représentés que par des cases, la couleur du drapeau ; on peut penser aussi (là, la forme de l’Etat ne disparaît pas, mais enfin…) au travail de Alighiero Boetti, un artiste italien qui avait fait faire des espèces de grandes tapisseries, où chaque État est coloré de son drapeau. (Téléphone) On en était où, qu’est-ce qu’on disait ? Je me demande si on dit l’essentiel sur les cartes, sans que je sache exactement ce qu’il faut dire d’essentiel sur les cartes. (Rires)
D.: Est-ce qu’il n’y a pas une transformation de la saisie mentale du réel, de la géographie physique, à travers le passage d’une cartographie «géopolitique» à une cartographie purement économique?
Et est-ce que, à terme, il n’y a pas de risque que les cartes que tu utilises, reproduis, ne soient plus considérées que comme des «vieilleries poétiques»?
F.: Sans doute, si l’on considère mes cartes comme des cartes qui permettraient de se repérer. Au même titre que l’on pourrait dire que les cartes vieillissent: j’utilise parfois des cartes qui sont déjà obsolètes. Je ne peins pas des cartes pour que l’on se repère dans un lieu.
D.: Tes cartes sont quand même précises.
F.: Oui, mais elles n’ont pas cette fonction-là. Elles ne peuvent pas vieillir, si tu veux…
D.: Tu disais toi-même que tu ne les inventes pas et que tu ne les inventerais pas, ce qui prouve bien, même si elles sont anciennes, qu’il y a un rapport avec un espace abstrait mais réel, qui est celui d’une géographie, du nom des lieux,..
F.: Oui, mais ces noms de lieux n’auraient aucune raison d’apparaître dans des cartes économiques… Si, peut-être dans des cartes touristiques, des cartes économiques qui seraient… alors voilà, on pourrait imaginer…
D.: Un tourisme économique!
F.: Llanthony est un lieu touristique au sud du pays de Galles, c’est paraît-il une très belle région. On pourrait imaginer qu’il existe une carte touristico-économique du pays de Galles qui indiquerait Llanthony. Je crois que je ne verrais pas d’inconvénient à l’utiliser. Cela me plairait même assez parce que, comme j’aime bien utiliser des cartes d’époques différentes pour un même lieu, s’il y avait une carte formellement complètement différente, cela serait intéressant. Mais, c’est vrai, ce ne serait pas l’utiliser pour les informations économiques qu’elle donnerait, ce serait que, par le plus grand des hasards, Llanthony s’y trouverait. Cela me ferait bien rire que d’utiliser ça, d’une façon un peu perverse; je ne prendrais pas vraiment en compte les données de la carte. Tout comme le fait qu’il y ait désormais un grand parking à côté de l’hôtel, qui était au Xllème siècle un ancien prieuré, me fait bien rire aussi…
D.: Penses-tu que «reconstruire une famille artistique» soit lié ou puisse être lié à l’idée d’avant-garde?
F.: En tout cas, pour moi, c’est très important. Je ne sais même pas si l’on est obligé de dire «famille artistique», d’ailleurs. Parce que quand je dis reconstituer une famille… C’est vrai que j’ai commencé par penser qu’il s’agissait d’une famille artistique, mais ce n’est pas seulement une famille artistique dans la mesure où, par exemple, Charcot n’est pas un artiste. Dire que c’est lié à une notion d’avant-garde, est-ce dire que tous les gens qui prétendent faire de l’avant-garde doivent obligatoirement reconstituer une famille? Je serais assez tenté de dire oui. Oui, cela m’intéresse plus que l’idée de rupture. De toute façon, les ruptures ont toujours été des recréations, des réorganisations.
D.: Pour toi, dans la notion d’avant-garde, ce qui est le plus important c’est l’idée de famille plutôt que l’idée de rupture?
F.: Ah oui. Enfin, en tout cas, pour mon travail, l’idée de famille est beaucoup plus importante que l’idée de rupture. Alors, dire que c’est ça pour tout le monde, je n’en sais strictement rien. Mais pour moi, c’est évident. Ce n’est pas d’une très grande originalité, mais j’allais dire que lorsque j’ai commencé à travailler, c’était pour faire la même chose que d’autres. En même temps c’était lié à des œuvres qui me dégoûtaient. Donc, il y avait sans doute cette idée de rupture… Aujourd’hui, c’est de moins en moins vrai: de moins en moins de choses me dégouttent. Il y a une rupture dans la mesure où l’on veut réorganiser un petit peu les choses. Recréer une famille, c’est créer une famille qui n’existait pas auparavant, donc on peut sans doute dire qu’il y a des ruptures à faire, Ne serait-ce que les ruptures des liens que l’on établissait auparavant et que l’on veut remplacer par d’autres.
D.: Qu’entends-tu par peinture littéraire, et à quoi l’opposerais-tu ?
F.: Alors ça, c’est très très difficile. Très très difficile, parce que c’est une question que je me pose souvent. C’est un terme que j’utilise mais que j’ai beaucoup de mal à définir. Le problème, c’est que dès que j’essaie de le définir (je ne sais pas ce que tu vas pouvoir faire avec ça), je me rends immédiatement compte que ce n’est pas ça.
D.: Peut-être peux-tu commencer par ce à quoi tu l’opposerais?
F.: Pour prendre des exemples, dans les avant-gardes des années 70, disons que Supports/Surfaces, ce n’est pas du tout une peinture littéraire. Et ce n’est pas une question d’abstraction/figuration puisque je pense que, d’une certaine façon, François Morellet – j’aurais beaucoup de mal à dire pourquoi – pourrait presque être classé dans les peintures littéraires. Bon, mais sans doute y a-t-il des degrés. Evidemment, ce ne sont pas seulement des artistes qui utilisent le texte.
D.: Tu parles de peinture littéraire, dans ton cas, parce qu’il y a des références littéraires dans ta peinture et que tu ne peux les éviter ?
F.: Ce n’est pas, je crois, au sens où j’utilise (on va peut-être se rapprocher de la réponse, là) des textes littéraires, mais c’est au sens où, dans l’esprit de la personne qui regarde, je crois qu’il se crée une sorte d’histoire, qui n’est pas une histoire précise, ce n’est pas la même histoire pour tout le monde… Et c’est là qu’il doit y avoir l’intérêt du travail. C’est pour ça que je travaille avec des polyptyques. Par exemple, mes premières batailles sur les clans d’Écosse étaient sur un seul panneau. C’était un peu la même construction, il y avait les deux tissus en présence, la carte, un texte - et les marges marbrées. Le fait que ces choses demeurent maintenant séparées dans les polyptyques et se reconstituent dans l’esprit du spectateur, c’est peut-être là qu’il y a quelque chose de littéraire.
D.: Plus généralement, quand tu parles de peinture littéraire, est-ce que c’est parce que cela fonctionne de cette manière dans l’esprit du spectateur, ou est-ce pour d’autres raisons? Par peinture littéraire tu entends tout ce qui se passe avec le mental, la pensée du regardeur?
F.: Oui, ce serait très proche, en fait, d’une peinture conceptuelle.
D.: Mais tu préfères ce terme de peinture littéraire?
F.: Oui, encore que j’utilise les deux pour parler de mon travail. Mais peut-être que je suis plus à l’aise; je préfère sans doute utiliser le terme de peinture littéraire, bien que plus vague, mais justement il a cet avantage. C’est drôle parce que je pense à l’une des oeuvres les plus importantes de l’art conceptuel: la pièce de Kosuth avec la chaise, c’est un peu ça. Tu as la définition de la chaise, la photographie de la chaise, et la réalité de la chaise. Les rapports que toutes ces choses ont avec l’esprit du spectateur.
D.: Peux-tu me réexpliquer pourquoi tu n’aimes pas la sculpture de Germaine Richier ?
F.: (Rires) Je préférerais que tu me demandes pourquoi j’aime le travail de tel ou tel… Pourquoi je n’aime pas Germaine Richier… (Rires) Eh bien c’est parce que ce n’est pas une œuvre littéraire ! (Rires) Je crois que c’est ça. Peut-être aussi… On pourrait dire qu’une oeuvre littéraire, c’est une œuvre qui est du côté de l’analyse des choses et non pas de l’expression, peut-être (c’est discutable), S’il y avait deux grandes familles en art à considérer, ceux qui font dans l’expression et ceux qui font dans l’analyse (ce ne sont pas des critères si mauvais que ça, finalement), je ne serais absolument pas dans l’expression.
C’est un travail d’analyse des liens qu’il y a entre les choses. En disant que c’est un travail d’analyse, je ne veux pas dire que c’est un travail désincarné. Au contraire, l’un des points de départ (et d’arrivée) de ce travail est autobiographique. C’est un travail qui tend presque à prouver son existence par tous les liens que l’on recrée autour de soi. Il y a quelque chose, par exemple, qui me fait très peur: les parfums m’intéressent bien que je n’y connaisse rien. J’aimerais savoir des choses sur les parfums, sur les odeurs, enfin, savoir cela de façon assez scientifique. Bon, parce que le problème se pose de choisir une eau de toilette. Un moyen serait d’aller voir quelqu’un, évidemment on ne peut pas faire confiance aux vendeuses, il faudrait aller voir un spécialiste et lui donner des indications, en partant de choses que l’on connaît: j’aime cette eau de toilette, et cette autre eau de toilette. C’est quelque chose qui m’effraie assez parce que j’ai l’impression que, peut-être parce que je n’y connais rien, je vais dire des choses complètement contradictoires, et cela va remettre en cause mon existence même. Il y a quelque chose de vraiment angoissant dans cette histoire d’eau de toilette. Mais vraiment, je crois.
C’est fou… comme en art… C’est très intéressant le parfum, parce que… tout le monde sait que l’on achète ça en fonction de la marque, en fonction de la publicité, et puis les gens sont d’une ignorance totale, beaucoup plus grande encore en parfum qu’en vin…
Les raisons pour lesquelles on achète un parfum sont tout à fait comparables aux raisons pour lesquelles un collectionneur achète des oeuvres d’art. Des raisons qui sont totalement extérieures à l’œuvre elle-même, (…)
J’ai l’espoir de pouvoir choisir deux parfums qui ne seraient pas en contradiction pour des spécialistes. Ou alors réussir par l’analyse à créer un lien entre ces contradictions, Mais derrière ça, il y a quand même l’angoisse que cette contradiction arrive à mettre en doute mon existence.
Ce qui me ravit, c’est le contraire, c’est quand je tombe, en lisant le Journal de Michel Leiris, sur un texte où il parle de Glencoe. Depuis des années, je travaillais sur les batailles d’Écosse, sur la bataille de Glencoe en particulier, je travaillais par ailleurs sur Leiris, et tout d’un coup, je vois que Leiris est allé à Glencoe, qu’il a collé une carte postale de Glencoe sur son cahier ; c’est évidemment là le contraire de cette angoisse que j’ai au sujet des parfums.
D.: Une fois que tu as décrypté tes propres liens, tu n’as pas l’angoisse que personne n’y comprenne rien ?
F.: Non, cela me paraît d’une telle évidence, cela me paraît même trop évident, c’est d’une simplicité telle… j’aurais plutôt honte de faire des choses aussi évidentes. En réalité, je n’ai pas peur que l’on ne comprenne pas… Non, j’ai plu-tôt peur de faire dans le lieu commun plutôt que dans l’abscons.
D.: Que penses-tu d’Internet, l’utilises-tu ou l’as-tu déjà utilisé ?
F.: Non, je ne l’ai jamais utilisé, je n’en pense rien. (Rires) Je ne sais pas, qu’est-ce que je pourrais répondre à ça, donne-moi des idées! (Rires) J’ai le défaut d’avoir beaucoup de mal à parler de choses comme ça… non, tu vois, j’ai des choses un peu plus originales à dire sur les eaux de toilette! (Rires) C’est ce que Olivier Le Bars doit me reprocher, c’est de faire dans le petit, sans doute. (Rires) En même temps (je ne m’intéresse pas qu’aux eaux de toilette), même si ce que je fais a une espèce de répercussion immense, je commence quand même par le petit.
D.: Tu fais de l’art conceptuel ?
F.: Ecoute, le problème de l’art conceptuel, c’est que c’est tellement galvaudé… Alors oui, au sens où presque tout le monde en fait, Non, au sens… Est-ce que j’en fait? Ça dépend, si l’on entend par conceptuel ceux qui font dans la pure réflexion en se moquant de l’effet visuel des choses, si c’est cela, non, absolument pas. Bertrand Lavier dit qu’il ne fait pas d’art conceptuel, parce que pour lui l’apparence visuelle des choses qu’il fait est importante.
D.: La séduction ?
F.: Oui, j’aurais tendance à bien aimer ce mot ; la présence des oeuvres. La capacité de ravissement.
D.: C’est important pour toi de copier des images?
F.: Oui, c’est très important. J’aime bien le côté besogneux. Ça prouve le côté presque sentimental par rapport à l’objet copié. C’est tout le contraire d’une froideur par rapport au document copié. Si je copiais photographiquement ces documents, il y aurait quelque chose de très très froid, alors que s’appliquer pendant des heures et des heures… c’est un mélange de froideur, de détachement par rapport aux choses et, en même temps, il y a quelque chose de très affectif et sentimental.
D.: Où est la part de ravissement, dans la copie?
F.: Quand je parlais de ravissement, ce n’était pas dans le rapport à mon propre travail: c’est le spectateur qui doit être ravi, dans tous les sens du terme. Mais c’est vrai qu’il peut y avoir quelque chose d’un peu extatique dans le fait de copier. Oui, surtout quand on copie des cartes géographiques. C’est extraordinaire… j’adore ça.
Pablo Duràn et Anthony Freestone, entretien, Aurora N°6, juin 1997