Puzzles et dominos
Anthony Freestone
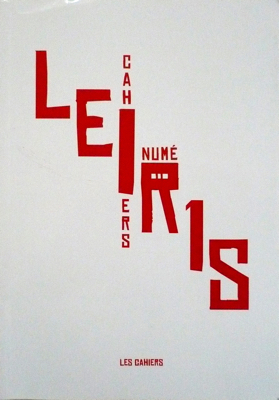
(Les Cahiers Michel Leiris N°1, novembre 2007)
Depuis janvier 1990 j’écris dans un cahier tous les livres que je lis. Le premier de la liste est l’Age d’Homme de Michel Leiris. Lu neuf mois avant sa mort, donc. Pour être exact : relu, après une première fois quelques dix ans auparavant. A vingt ans, je lisais beaucoup Sartre et Beauvoir et je cherchais à connaître les auteurs qui traversaient les Mémoires. Leiris était l’un d’entre eux. Je n’ai aucun souvenir de cette lecture, elle ne me marqua pas. La seconde lecture fut un choc : comment avais-je pu passer à côté de cela ? Je ne sais ce qui me fit relire Leiris ; peut-être une émission sur France Culture qui à l’époque était une radio de grande qualité. Peut-être la rencontre avec Alain Jouffroy quelques mois auparavant, en mai 1989. Alain Jouffroy, poète, ancien surréaliste, avait, en 1969, préfacé Haut Mal.
Le premier tableau que je fis évoquant Michel Leiris fut Louis Seye & Michel Leiris (1993). J’avais déjà en 1989 travaillé sur un portrait de Louis Seye, un ami mi-sénégalais, mi-djiboutien que je représentai sous l’uniforme des tirailleurs sénégalais. J’avais été touché en voyant des reportages filmés durant la première guerre mondiale présentant ces soldats noirs occupés sous leur uniforme de l’armée française à des danses traditionnelles dans ce qui semblait être la cour d’une banale ferme lorraine. J’avais lu le livre de Marc Michel, L’Appel à l’Afrique et fait des recherches aux archives de l’armée au château de Vincennes. En mars 1991, j’avais lu L’Afrique Fantôme. L’itinéraire de la mission à laquelle Leiris participa me frappa : Dakar-Djibouti. C’était là l’arbre généalogique même de Louis Seye. Je décidai alors de faire un second portrait qui expliciterait cette similitude. Louis Seye et Michel Leiris est un polyptyque sur les liens entre le sud et le nord, entre l’Ouest et l’Est. Les tirailleurs sénégalais emmenés au nord sur le front et la mission Dakar-Djibouti traversant l’Afrique d’Ouest en Est comme le père de Louis l’avait fait. C’est aussi un hommage à la peinture italienne médiévale, celle de Giotto, de ses crucifix que je découvrais dans ces mêmes années. Le polyptyque en reprend la forme avec les photographies des parents de Louis qui remplacent ici les figures de Marie et de saint Jean (Eglises de Santa Maria Novella et San Felice, Florence). Une carte de la mission Dakar-Djibouti remplace l’axe horizontal de la croix. Le titre L’Afrique fantôme est repris dans un cartouche en prédelle.
C’est en juillet 1994, pendant un séjour en Toscane, que je lu le Journal de Leiris. Je remarquai cette note écrite le 17 janvier 1978 : Plaisir pris à coller deux cartes postales dans ce cahier (vue du Rialto à Venise et paysage écossais) ; De plus en plus, ce journal devient, d’une part, un instrument de travail (lieu des premiers brouillons, en vrac et non dégrossis) et, d’autre part, recueil de reliques. (Journal, p.689-690) Au milieu du livre, le document 7 présente une carte postale avec la note suivante : Glencoe, Argyll. Carte postale collée en regard du 16 août 1966, avec cette note écrite postérieurement (le 17 janvier 1978) : « Vu, lors des avant-dernières vacances, des paysages écossais quelque peu abîmés par des plantations utilitaires de sapins. » Ce « plaisir pris à coller une vue de Venise et un paysage écossais» n’était il pas le même que celui que j’éprouvais dans mon travail à juxtaposer des documents hétérogènes pour en révéler les secrètes affinités ? De plus, j’avais, dès 1992, dans le cadre de ma série sur les batailles entre clans d’Ecosse, travaillé sur Glencoe où s’opposèrent, en 1692, le clan des MacDonald et celui des Campbell. Ce passage du journal fut donc utilisé dans deux tableaux : Recueil de reliques (1994) et Venise & Glencoe (2005). Ce dernier tableau fut peint pour une exposition que j’organisais : Nouvelles Littéraires, qui présentait des œuvres d’artistes qui avaient travaillé sur un écrivain de leur choix. Ce parti pris littéraire, cette volonté de montrer que la source des œuvres pouvaient toujours être l’écrit, je la soulignais dans un court texte introductif : Il me semble de plus en plus ennuyeux de lire des textes sur l’art, la littérature m’apparaît autrement exaltante. Rien ne me semble plus triste que d’entendre un artiste parler du dernier livre sur l’art, surtout contemporain. Ce qui me donne souvent envie de travailler, c’est la littérature. J’ai voulu voir si, ce qui a été longtemps un point de départ pour une œuvre, pouvait l’être encore. Peut-être y a-t-il quelque provocation à dire, alors que des artistes se sentent obligés d’aller prêcher la bonne parole dans les cités, qu’ici, comme disait le tailleur de Michel Leiris, nous ne regardons pas ce qui se passe dans la rue.
Les amateurs de Leiris se rappelleront ce passage qui figure page 977 de l’édition de la Pléiade.
En octobre 1992, je lu Biffures. Je remarquai alors ce passage : Telles sont donc, à mon sens, les bases à partir desquelles on pourrait imaginer une « philosophie du déménagement », fondation de pierres sèches dont les parties constituantes, prises à l’état brut et laissées autonomes doivent (comme dans toute construction d’idées qui se respecte) tenir par leur gravité propre et n’ont besoin pour être unies entre elles de l’artifice d’aucun ciment. (Pléiade, p.72) Cette description de la Philosophie du déménagement me ramenait à mon propre nom : freestone. Freestone, en Anglais, peut être traduit par pierre libre mais « a freestone » est une pierre de taille, c’est à dire une pierre taillée dont le poids et la régularité suffisent à sa stabilité. Une pierre de taille ne nécessite pas de ciment, elle tient « par sa gravité propre » elle est autonome et peut être éventuellement réutilisée pour une nouvelle construction. J’avais déjà auparavant travaillé sur mon propre nom. Au cours d’un voyage au Pays de Galles à la fin des années 80, j’avais découvert un texte écrit au XIIème siècle par un religieux anglo-gallois : The Journey through Wales. Gerald of Wales accompagnait l’archevêque de Cantorbéry en un voyage au Pays de Galles afin de lever une armée pour la croisade : The Journey through Wales. Lors d’une étape de son voyage, Gerald décrit la vallée de Llanthony où un phénomène géologique, qu’il qualifie de miracle, fait sans cesse apparaître sur les flancs des collines de nouvelles pierres qui servent à construire l’église du village. Ces pierres, Gerald les nomme des freestones. Plusieurs travaux de la série Gerald of Wales, réalisés entre 1991 et 1996, évoquent cette histoire : Gerald of Wales I, II et III (1991, 1994, 1995) ou Babel’s Tower (1996). Je décidai de rapprocher ces deux textes en 1998 dans le polyptyque La Tour de Babel où j’associais sur un même panneau le texte de Gerald et celui de Leiris. Un premier panneau présentait la copie d’une enluminure médiévale présentant la construction de la Tour de Babel, un deuxième juxtaposait deux traductions d’un texte de Freud comparant le travail d’un archéologue découvrant des inscriptions cachées et à moitié effacées, parfois bilingues, au travail de l’analyste. Un troisième était une copie peinte d’une sculpture d’Andy Warhol qui apparaissait soudain comme une sorte de Tour de Babel moderne. J’avais, deux ans auparavant, déjà utilisé le texte de Leiris, traduit en anglais, dans un triptyque Babel’s Tower. Là encore, je copiai une enluminure médiévale sur le second panneau tandis qu’un troisième était constitué de cinq phrases en différentes langues (hindi, chinois, turque vietnamien et anglais) dont la traduction française serait : Eprouvez-vous parfois des difficultés à vous faire comprendre en anglais ? Ce texte provenait d’un bureau d’aide sociale du quartier de Londres où j’habitais alors. Un troisième travail, Pierres de taille (1999) présenta sous la forme d’un diptyque la même phrase de Leiris accompagnée d’une copie d’une autre enluminure médiévale figurant des tailleurs de pierres.
D’autres écrivains apparaissent régulièrement dans mon travail : Lewis Carroll, Patrick Modiano… d’autres plus épisodiquement (André Hardellet, Henri-Pierre Roché, Marcel Proust…) Pour certains autres, parmi mes préférés (Paul Léautaud, Emmanuel Bove…) je ne suis pas encore parvenu à les intégrer. Leiris demeure une pièce centrale du puzzle. C’est au début des années 90 que s’est constitué mon travail que l’on pourrait décrire comme la construction d’une sorte d’arbre généalogique, une sorte de monde idéal ou un autoportrait paradoxal dans lequel l’auteur n’apparaîtrait jamais directement. Je travaille sur les liens entre des choses habituellement perçues comme distinctes. Pour cela, je copie en les peignant divers documents : textes, cartes géographiques, tissus écossais, photographies etc. Les œuvres se présentent habituellement sous la forme de polyptyques qui s’apparentent en quelque sorte au jeu de dominos, quand des pions, dispersés en début de partie, se trouvent petit à petit liés les uns aux autres au fil des combinaisons. La lecture de Leiris a sans doute été essentielle pour mettre cela au point et lorsque l’on me demande quels ont été les artistes dont je me sens proche, ce ne sont pas des peintres que j’ai d’abord envie de citer mais bien Michel Leiris.
Anthony Freestone décembre 2006
Publié dans Les Cahiers Michel Leiris, N°1, novembre 2007.
Association des Cahiers Leiris, 44 route de Conflans 70300 Meurcourt, France