Catalogue Saint-Fons
Jean-Marc Huitorel
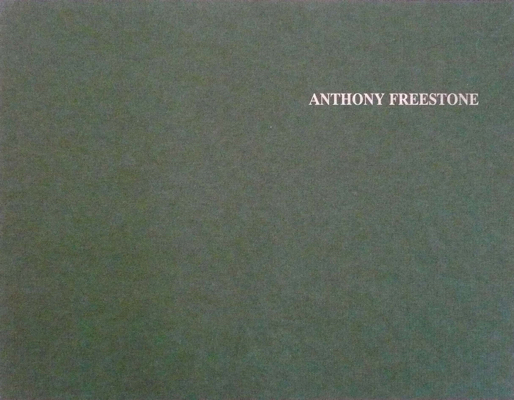
Texte pour le catalogue du Centre d’art de Saint-Fons
La plupart des contempteurs de l’art moderne et contemporain justifient leur rejet par le définitif “Je n’y comprends rien”. Variantes : “Cela n’a aucun sens”, “C’est trop conceptuel”, “Il faut avoir le mode d’emploi”, etc. etc. Aucune de ces préventions, en revanche, à l’égard de l’art classique, de la peinture en particulier. Comme si les Crucifixions . les Suzanne et les vieillards, les Vénus au miroir, les allégories de Poussin ou les compositions de Piero n’avaient aucun secret pour eux, comme si tout était donné là, dans l’immédiateté du tableau, sans ombre et sans épaisseur, dans la nudité trompeuse des choses admises. C’est que le désir de voir, une fois satisfait le besoin d’image, s’accommode fort bien des lacunes sémantiques. Qu’est-ce que l’opacité d’un tableau de Bosch ou de Carpaccio, l’exégèse biblique ou la symbolique des couleurs, que pèsent les rituels chronologiques et différenciés des Annonciations, les codes alambiqués des Vertus théologales face à l’évidence d’un corps, face à l’image d’un objet. face à la splendeur des paysages? Cette caution imagière, une part essentielle des avant-gardes a refusé de l’accorder. Dans l’époque et les différents contextes dans lesquels cela se passa, force est de reconnaître que c’était là justesse et urgence, devoir de décilement et nécessité intérieure. Puis, dans la seconde moitié de ce siècle, on a constamment oscillé entre l’expérimentation directe du monde (happenings, performances, jusqu’aux modalités récentes de l’appréhension du réel) et le flot d’images que photographie et vidéo ont déversé dans le champ de l’art. Si l’on excepte les représentants de la Figuration Narrative, quelques grandes figures atypiques comme Malcom Morley et, dans une moindre et plus chichiteuse mesure, certaine peinture cultivée du tournant des années 70-80, on s’est assez peu intéressé à la duplicité d’une peinture partagée entre les histoires compliquées qui s’y nichent et l’immédiateté rétinienne des représentations mimétiques entre les arcanes du sens et les plaisirs visuels. C’est cette voie étroite qu’emprunte Anthony Freestone. C’est à partir de ce double positionnement qu’il pose, depuis une bonne dizaine d’années, la plupart des questions qui concernent la peinture actuelle et qu’il parvient, me semble-t-il, à leur apporter sinon des réponses au moins des raisons de continuer à interroger cette drôle d’activité.
Plutôt que l’activité d’un peintre au sens traditionnel, c’est celle de copiste qu’Anthony Freestone revendique volontiers. En effet, ce qui se voit sur ses tableaux provient toujours de documents préexistants : miniatures, cartes de géographie, photographies, tissus, dessins, oeuvres diverses, textes, etc. La plupart du temps, ces documents sont reproduits à l’aide d’un épiscope. Les notions de dextérité ou de talent cèdent donc ici la place au labeur consciencieux et sans gloire, à l’application patiente, celle qui fait que, comme le disait Boileau, cent fois sur le métier il faut remettre l’ouvrage. Soit donc l’oeuvre d’art au stade de sa reproductibilité technique, envisagée non plus à l’aune du geste et de la touche mais bien à celle d’une économie des images, de la masse des visibles disponibles et de la manière d’en user. Cette image du copiste apparaît dans divers tableaux (1991, 1994) sous les traits de Gerald of Wales, figure emblématique de l’univers de Freestone sur laquelle nous reviendrons bientôt. En décidant que ses tableaux seraient dans une large mesure des copies, Anthony Freestone signait son appartenance à l’époque, à un temps où, dans la suite des appropriationnistes américains (Sherrie Levine ou Louise Lawler, parmi d’autres) et comme en très lointain souvenir du ready made, un nombre croissant d’artistes, photographes, vidéastes, quelques peintres dont l’autoappropriationniste Piffaretti, s’appliquent à l’usage personnel, parfois critique, d’images déjà faites. C’est également à la question du quoi peindre que répond ainsi Freestone. On sait par ailleurs que les peintres, à quelques rares et très fragmentaires exceptions près, peignent les images. c’est-à-dire les autres peintures, plutôt que la réalité et l’on peut appliquer aux tableaux ce qu’Umberto Eco disait des livres, à savoir qu’ils “parlent des autres livres, non du monde”. Anthony Freestone, quant à lui, non seulement copie d’autres images mais également des textes, des textes dont il fait, sinon des images, au moins des tableaux. Dans les sujets ainsi reproduits, on reconnaîtra la plupart des catégories de la peinture : le portrait et le paysage, la nature morte et les scènes de genre. On trouvera également, quoique de manière totalement minée, la distinction problématique entre la figuration et l’abstraction comme entre le conceptuel et le rétinien. Par exemple, des motifs de tissu écossais reproduits à l’acrylique sont le sujet de nombreux tableaux, qu’ils fassent partie d’ensembles articulés, ou qu’ils existent de manière autonome. Il s’agit à première vue de motifs abstraits, décoratifs éventuellement, mais fondés sur une composition strictement orthogonale. Ce sont les tartans des différents clans de la vieille Écosse. Les tableaux seuls, d’un format constant (150 x 150) s’inscrivent dans un programme : l’artiste a entrepris, une fois établie, à partir de sources recoupées, la liste alphabétique des clans et des tartans qui leur correspondent (certaines familles en possèdent plusieurs), de réaliser sur panneau l’ensemble de ces signes d’appartenance. Sur les cent soixante trois actuellement prévus, il en a produit à ce jour une bonne trentaine. Le projet n’est pas anodin. Outre que cela évoque des entreprises programmatiques comme celle de Julije Knifer1, une telle procédure pose avec beaucoup de pertinence la question du sujet de la peinture sur laquelle s’est fondée l’entreprise moderniste et qui trouve ici une relecture parmi les plus subtiles qui se puisse voir. En effet, on y trouve, en vrac, le problème des signes identitaristes, c’est-à-dire une autre manière de parler des drapeaux en en contaminant l’approche par la référence décorative, l’ironie vis-à-vis de la raideur solennelle des géométriques abstraits, le rapport nature/culture (les tartans avaient aussi une fonction de camouflage) comme Alighiero Boetti sut, à sa manière, la poser dans Mimetico . La manière de peindre, elle-même, ne laisse pas de surprendre. A l’éxécution froide et un peu sommaire des premiers tableaux, a succédé une technique beaucoup plus élaborée, faite de jus et de glacis, comme si l’artiste, par une élégante pirouette, avait voulu signifier que, malgré qu’il en ait, il savait également bien peindre. Concernant le couple conceptuel/rétinien, on retiendra l’exemple des textes. Les sources littéraires de l’oeuvre de Freestone, nombreuses et variées, constituent l’un des éléments essentiels des articulations sémantiques que nous allons bientôt évoquer. De nombreux tableaux sont constitués d’extraits d’ouvrages, de fragments de textes prélevés aussi bien dans la Bible (la Tour de Babel) que chez Freud, Michel Leiris, André Hardellet ou dans divers dictionnaires. La typographie ainsi que les couleurs y sont soigneusement pensées. Dans le polyptyque intitulé Idalion , le vert de la typo évoque les frondaisons de Vincennes alors que le beige rappelle les façades de la rue d’Idalie : paysage donc : mieux, le texte comme paysage et, somme toute, dans la logique des tartans. Ailleurs, le noir et le beige reprendront la bichromie des éditions Gallimard. Le texte, ici, remplit une fonction similaire à celle des photographies chez André Breton, quoique de manière inversée : si, dans Nadja , la photographie dispensait de la fastidieuse description, le texte, chez Freestone, devient déclencheur d’images (ou de rapports sémantiques, ce qui, au fond, n’est pas si différent).
Anthony Freestone, outre l’immédiateté visuelle, emprunte à la peinture ancienne, comme nous le suggérions plus haut, puise dans le second versant de sa nature, c’est-à-dire sa capacité narrative. Nombre de ses oeuvres se présentent sous la forme de polyptyques narratifs dont chaque tableau constituerait un chapitre de l’histoire qui s’y raconte. On imagine bien cependant qu’il ne s’agit pas ici de narrations de type purement romanesque ou telles qu’on en trouve clans les bandes dessinées. Les narrations de Freestone défient la chronologie, se jouent de la vraisemblance réaliste et convient à leurs festins les éléments les plus divers, ainsi que nous l’avons déjà noté. Le récit psychanalytique, comme la métaphore archéologique (la fouille, les strates) sont les mieux à même de rendre compte de la démarche de l’artiste. L’agencement des polyptyques rappelle en effet davantage les libres associations du récit analytique que les aléas de l’écriture automatique. Ces associations et les glissements de sens qu’elles produisent s’embrayent généralement à partir des signifiants, qu’ils soient iconiques ou linguistiques, et le fil qui les relie est souvent. de près ou de loin, fourni par des éléments de la biographie de l’artiste. Il n’est pas un polyptyque dont la description n’apporte la confirmation de ces attendus. Dans Charcot père et fils (1997) par exemple, Charcot père, que connut Freud dont on sait la dette envers le neurologue, entraîne le signifiant second. Charcot fils, qui, tout comme Scott, explora les pôles (l’inconscient et les terres vierges comme métaphores réciproques). Puis arrive naturellement la figure de Freud. Parallèlement, la traduction anglaise du nom du bateau à bord duquel mourut l’explorateur, le Pourquoi pas? , reproduite d’un dictionnaire, donne Why not? qui, à son tour, glisse sur la célèbre pièce de Marcel Duchamp, Why not Sneeze Rrose Sélavy? En référence à l’explorateur, collègue de Charcot fils, un tableau présente le texte expliquant l’origine du clan des Scott et le tout s’achève dans la synthèse picturale que constitue la reproduction de leur tartan. Chaque ensemble repose ainsi sur des proximités et des connexions, qu’elles soient inédites ou qu’elles réapparaissent dans d’autres configurations. Dans La Tour de Babel (1998), par exemple, on retrouve le jeu sur le patronyme Freestone (free stones, ces blocs de marbre qu’on trouve dans la campagne galloise et qu’évoque Gerald of Wales dans sa relation de voyage mais aussi Llanthony, lieu où l’on trouve ces pierres) associé cette fois à l’image de la Tour de Babel qui pose la question de la traduction (que l’on retrouvera dans l’oeuvre intitulée Babel et qui débouche sur la mention d’un texte de Freud sur l’hystérie où il compare le travail de l’analyste à celui de l’archéologue) mais aussi à celle de la sculpture (Babel comme métaphore de l’art), ce qui autorise la référence à I’empillement d’Andy Warhol (Cartons superposés de Brillo, Del Monte et Heinz, 1964, dérisoire et véritable tour de Babel contemporaine). Le polyptyque se clôt (si c’est possible) sur la juxtaposition du texte de Gerald of Wales, évoqué à l’instant, et de ces lignes de Michel Leiris (Biffures, 1948) que je restitue ici car elles résument à elles seules le principe qui sous-tend les associations qu’établit Freestone : " Telles sont donc, à mon sens, les bases à partir desquelles on pourrait imaginer une philosophie du déménagement , fondation de pierres sèches dont les parties constituantes, prises a l’état brut et laissées autonomes doivent (comme dans toute construction d’idées qui se respecte) tenir par leur gravité propre et n’ont besoin pour être unies entre elles de l’artifice d’aucun ciment. " On le voit, il ne s’agit pas ici d’un récit linéaire mais d’une très stimulante synchronie dont le rébus ne se fige jamais dans un ordre attendu et dont l’ouverture constante permet des variations sur l’accrochage des éléments au mur comme sur la lecture qu’on peut en faire. Chaque polyptyque de Freestone fonctionne à l’image de l’esprit et de ses jeux. Si la chaîne sémantique qui s’y déroule n’est pas celle du langage articulé conventionnel, elle ne s’inscrit pas moins dans le vif de l’activité psychique, intellectuelle et culturelle du sujet qui assume alors pleinement cette qualité de cosa mentale que Léonard attribue à la peinture. N’était le manque de place, nous pourrions décrire chaque polyptyque et fournir ainsi quelques clés de lecture supplémentaires. Toutefois, le regardeur qui ne les possède pas pourra naviguer librement d’un tableau à l’autre, y hasarder ses propres associations ou se contenter de la contemplation d’ensembles qui n’oublient jamais qu’ils sont avant tout des tableaux et que, cela étant, ils s’offrent au regard dans la cohérence plastique que ne font que renforcer les infatigables facéties de l’intelligence analogique.
Jean-Marc Huitorel, catalogue Saint Fons, juillet 1999
Parallèlement, la traduction anglaise du nom du bateau à bord duquel mourut l’explorateur, le Pourquoi pas? , reproduite d’un dictionnaire, donne Why not? qui, à son tour, glisse sur la célèbre pièce de Marcel Duchamp, Why not Sneeze Rrose Sélavy? En référence à l’explorateur, collègue de Charcot fils, un tableau présente le texte expliquant l’origine du clan des Scott et le tout s’achève dans la synthèse picturale que constitue la reproduction de leur tartan. Chaque ensemble repose ainsi sur des proximités et des connexions, qu’elles soient inédites ou qu’elles réapparaissent dans d’autres configurations. Dans La Tour de Babel (1998), par exemple, on retrouve le jeu sur le patronyme Freestone (free stones, ces blocs de marbre qu’on trouve dans la campagne galloise et qu’évoque Gerald of Wales dans sa relation de voyage mais aussi Llanthony, lieu où l’on trouve ces pierres) associé cette fois à l’image de la Tour de Babel qui pose la question de la traduction (que l’on retrouvera dans l’oeuvre intitulée Babel et qui débouche sur la mention d’un texte de Freud sur l’hystérie où il compare le travail de l’analyste à celui de l’archéologue) mais aussi à celle de la sculpture (Babel comme métaphore de l’art), ce qui autorise la référence à I’empillement d’Andy Warhol (Cartons superposés de Brillo , Del Monte et Heinz , 1964, dérisoire et véritable tour de Babel contemporaine). Le polyptyque se clôt (si c’est possible) sur la juxtaposition du texte de Gerald of Wales, évoqué à l’instant, et de ces lignes de Michel Leiris (Biffures, 1948) que je restitue ici car elles résument à elles seules le principe qui sous-tend les associations qu’établit Freestone : " Telles sont donc, à mon sens, les bases à partir desquelles on pourrait imaginer une philosophie du déménagement , fondation de pierres sèches dont les parties constituantes, prises a l’état brut et laissées autonomes doivent (comme dans toute construction d’idées qui se respecte) tenir par leur gravité propre et n’ont besoin pour être unies entre elles de l’artifice d’aucun ciment. " On le voit, il ne s’agit pas ici d’un récit linéaire mais d’une très stimulante synchronie dont le rébus ne se fige jamais dans un ordre attendu et dont l’ouverture constante permet des variations sur l’accrochage des éléments au mur comme sur la lecture qu’on peut en faire. Chaque polyptyque de Freestone fonctionne à l’image de l’esprit et de ses jeux. Si la chaîne sémantique qui s’y déroule n’est pas celle du langage articulé conventionnel, elle ne s’inscrit pas moins dans le vif de l’activité psychique, intellectuelle et culturelle du sujet qui assume alors pleinement cette qualité de cosa mentale que Léonard attribue à la peinture. N’était le manque de place, nous pourrions décrire chaque polyptyque et fournir ainsi quelques clés de lecture supplémentaires. Toutefois, le regardeur qui ne les possède pas pourra naviguer librement d’un tableau à l’autre, y hasarder ses propres associations ou se contenter de la contemplation d’ensembles qui n’oublient jamais qu’ils sont avant tout des tableaux et que, cela étant, ils s’offrent au regard dans la cohérence plastique que ne font que renforcer les infatigables facéties de l’intelligence analogique.
Jean-Marc Huitorel, catalogue Saint Fons, juillet 1999
Peintre d’origine croate, né en 1924. Membre du groupe néo-dadaïste Gorgona. Utilise exclusivement, en noir et blanc, la figure du méandre géométrique. Très tôt, Knifer a amassé une quantité considérable de dessins à la mine de plomb qui constituent la réserve de ce qu’il réalisera ensuite sur toile. Le nombre de ces dessin est tel que, quand bien même il lui sera donné de vivre très longtemps et de travailler beaucoup, il ne parviendra jamais à en peindre la totalité. Ainsi l’oeuvre de Knifer est-elle tout à la fois déjà achevée et à jamais inachevable. ↩︎